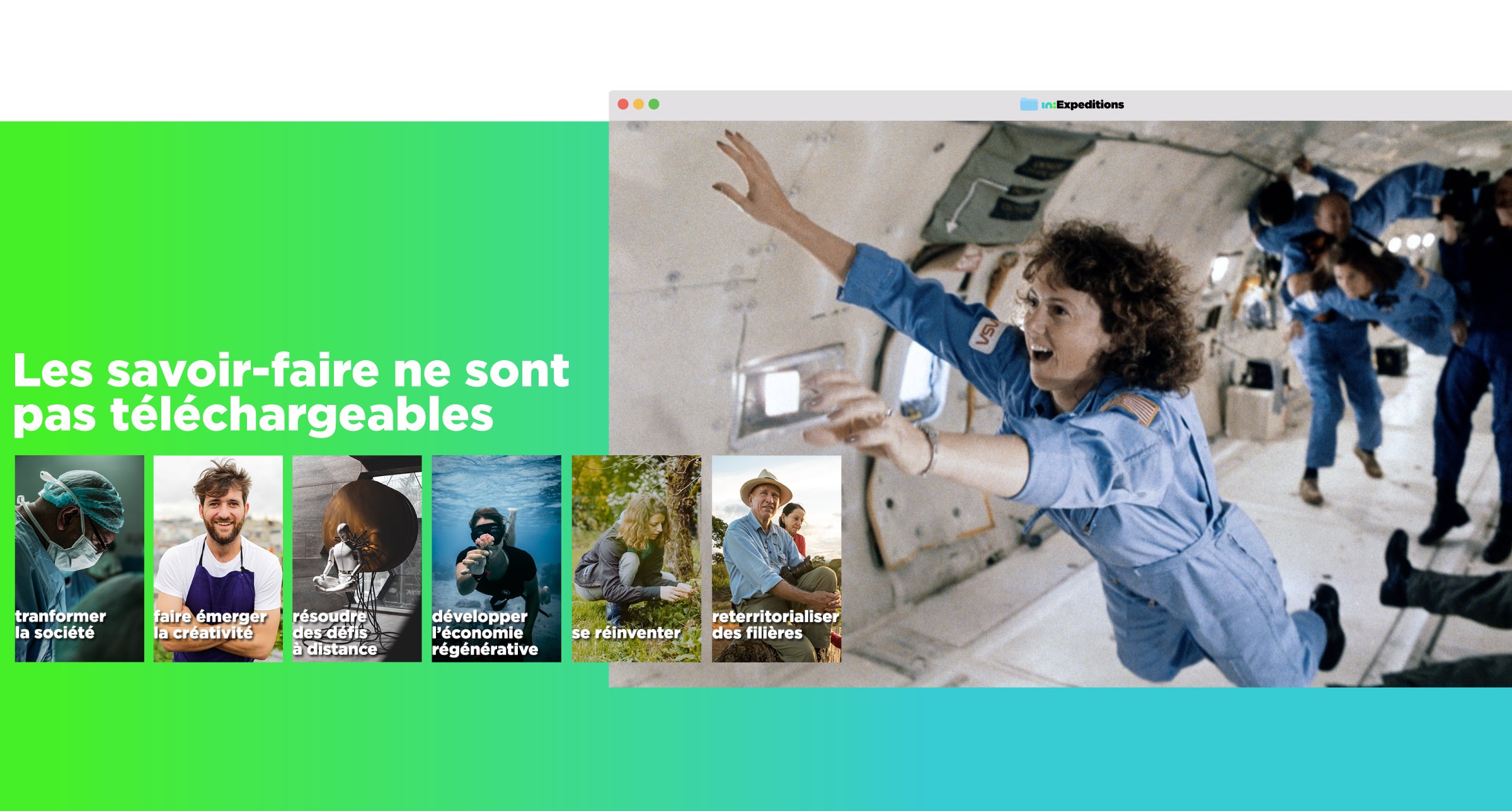Journée mondiale de la Biodiversité 🌍
Nous sommes à l’aube d’une sixième extinction de masse. Mais comment agir lorsqu’une problématique concerne tous les champs et toutes les strates d’une société ? Par où commencer ? Avec qui travailler ? Je suis allée à la rencontre de l’organisme public qui cherche à relever le défi immense de la protection du vivant.
Faut-il le rappeler ? Le vivant meurt ! Le rythme d’extinction des espèces est 100 à 1000 fois supérieur au rythme naturel constaté lors des 10 millions d’années passées, les populations sauvages de vertébrés ont chuté de 60% en moins de 50 ans au niveau mondial, et 22% des oiseaux communs spécialistes ont disparu entre 1989 et 2017. En France, l’Office Français de la Biodiversité (OFB) est le premier établissement public entièrement dédié à cette cause. Depuis plus d’un an, ses membres agissent sur tout le territoire pour la protection du vivant.
Curieuse de comprendre la genèse et les enjeux d’un projet d’une telle envergure, j’ai contacté Frédérique Chlous, chercheuse et professeur en anthropologie sociale au Muséum National d’Histoire Naturelle et présidente du conseil scientifique de l’OFB. L’enseignante-chercheuse a accepté de me dévoiler les coulisses du travail du conseil scientifique de cette agence hors du commun.
La genèse d’un projet ambitieux
L’OFB naît le 1er janvier 2020 de la fusion entre l’ancienne agence française de la biodiversité et l’office national de la chasse et de la faune sauvage. L’office est placé sous la tutelle des Ministères de la transition écologique et de l’agriculture. Ses prérogatives sont extrêmement larges : il crée et diffuse des connaissances sur le sujet de la biodiversité, intervient en amont des politiques publiques, contribue à la gestion et la restauration des espaces protégés, assure les missions des polices administrative et judiciaire relatives à l’eau et à la biodiversité, et mobilise la société autour de projets de protection de la biodiversité.
“L’ambition de l’OFB est immense !” commence par s’enthousiasmer la chercheuse. “La pluralité des missions qui lui sont confiées et sa forte implantation sur les territoires en font un organisme tout à fait unique, quand on le compare aux autres agences publiques de la biodiversité qui existent à l’international”.
Deux mots d’ordre : local et transversal
Composé de vingt-cinq membres (parité homme-femme), le conseil représente de nombreux champs disciplinaires : “il y a plusieurs écologues avec des spécialités diversifiées (biologie, écologie forestière, écologie marine…) mais aussi des chercheurs en sociologie, anthropologie, philosophie, droit, économie, sciences de la gestion, géographie…” énumère Frédérique Chlous. “Cette interdisciplinarité est passionnante, et elle nous permet de nous saisir des questions posées de manière transversale et systémique, ce qui est absolument nécessaire” poursuit-elle. J’apprends néanmoins que la transversalité est source de difficultés supplémentaires pour les scientifiques, habitués à travailler en silo. “Nous parlons tous des langues différentes” raconte Frédérique Chlous. “En rédigeant un texte pour l’OFB, nous avons remarqué que nous n’avions pas forcément les mêmes définitions pour certains concepts. Il nous faut nous accorder sur les termes ou identifier nos divergences”. Par ailleurs, les méthodes de travail des scientifiques diffèrent selon leur champ disciplinaire : les données sont quantitatives pour certains, qualitatives pour d’autres, les temporalités et les espaces traités varient... “C’est un défi”, résume la présidente du Conseil, “mais il faut continuer à travailler ensemble si l’on veut éclairer les demandes précises de l’OFB”.
Les enjeux de la biodiversité étant naturellement territorialisés, je m’interroge sur la pertinence d’une agence nationale centralisée pour assurer la restauration et la protection du vivant. Je demande donc à Frédérique Chlous quelle est l’échelle de leur action. Réponse : elle est double. L’Office agit au niveau national “sur les sujets de connaissance de la biodiversité, de travail en amont des politiques publiques, de gestion des aires protégées” notamment. Mais, forte de ses 90 services départementaux, l’organisme déploie également son action de manière territorialisée, partout en France. Plusieurs expérimentations locales sont notamment mises en œuvre pour mobiliser les citoyens à l’échelle de leur territoire. L’initiative des atlas communaux de la biodiversité invite par exemple les communes à recenser la biodiversité présente sur leur territoire. L’action “territoire engagé pour la nature” incite également les communes à intégrer la biodiversité dans l’ensemble de leurs politiques urbaines.
Non seulement la déclinaison locale des prérogatives de l’OFB rend ses actions plus effectives, mais elle permet aussi d’incarner la protection de la biodiversité au niveau individuel. “D’un point de vue anthropologique, cette échelle est intéressante”, confirme Frédérique Chlous, “car elle ramène les sujets très larges de la biodiversité à des questions plus simples à appréhender, plus familières. Il y a souvent un attachement des individus à leur territoire. Comprendre son territoire et agir en son sein est plus simple que d’appréhender les enjeux au niveau de la planète. Les transformations à l’échelle locale prennent plus de sens”.
“L’interdisciplinarité est passionnante et absolument nécessaire.” 🕸️
Derrière la protection de la biodiversité, des valeurs fondatrices
La transversalité et la territorialisation de l’action sont donc les fils rouges pour expliquer les modalités de son action. Mais ce qui m’intéresse par-dessus tout, c’est la partie du travail la moins visible; celle qu’on ne peut pas lire sur le site de l’agence. Je fais part de ma curiosité à Frédérique Chlous. Par son expertise et ses recommandations, le Conseil Scientifique insuffle nécessairement l’esprit général du travail de l’Office français de la biodiversité. Comment ce collectif a-t-il défini une éthique et des principes directeurs pour les actions de l’organisme ? Frédérique Chlous m’explique que, fort de son expertise multiple, le Conseil Scientifique a discuté des valeurs qui doivent être associées à l’action sur la biodiversité.
Pour ce faire, le Conseil a commencé par réfléchir aux trois valeurs philosophiques inhérentes à la biodiversité. De toute évidence, la biodiversité a une valeur instrumentale : elle est une ressource utile à l’Homme. La biodiversité a aussi une valeur relationnelle : elle offre aux humains des relations avec la nature et les non-humains. Enfin, la biodiversité a une valeur intrinsèque, indépendante des humains. Ce travail a permis au Conseil Scientifique d’ériger un principe fondateur de l’action de l’OFB, m’explique Frédérique Chlous : “ce qui nous semble essentiel, c’est que ces trois valeurs soient discutées et irriguent toutes nos réflexions sur la biodiversité. Ainsi, lorsqu’on met en place une politique publique, nous devons faire en sorte de contribuer au respect de la valeur instrumentale, relationnelle et intrinsèque de la biodiversité”.
Un deuxième principe érigé comme essentiel par le Conseil Scientifique concerne l’équité sociale et environnementale : “il est absolument indispensable que les politiques publiques de la biodiversité prennent en compte, en amont et en aval, les questions d’inégalités sociales, environnementales et écologiques, pour aller vers l’équité sociale” affirme Frédérique Chlous. Elle me cite l’exemple de la mise en place d’une aire protégée, qui peut exclure certaines activités sociales qui dépendent de ce territoire. De même, l’accès à l’alimentation saine et locale, aux espaces naturels et aux aménités (les bienfaits procurés par l’environnement) ne peuvent pas être des privilèges. “Tous ces sujets sont très liés aux questions de ségrégation géographique et environnementale. Les populations exclues de ces droits ou subissant les altérations de l’environnement sont également souvent issues de milieux sociaux ou économiques défavorisés”, poursuit Frédérique Chlous. “Les États-Unis ont une approche assez ethnique ou genrée de ces questions, alors que ces aspects ne sont que très peu pris en compte dans les politiques publiques en France. Or il y a ici un vrai enjeu scientifique et politique : il est question de construire une société juste”. Je suis conquise par cette approche de la protection de la biodiversité qui rejoint l’idée que, de la même manière que le monde du vivant est interconnecté, notre réponse aux enjeux environnementaux doit être couplée à la réponse aux autres enjeux sociétaux.
"Il est question de construire une société juste" 🌐
Faire de la protection de la biodiversité un projet de société
Le dénominateur commun de la philosophie et des modes d’action de l’OFB me semble assez évident : il s’agit de fédérer les citoyens des territoires autour d’un projet commun de protection du vivant. Frédérique Chlous me confirme que le sujet de la biodiversité peut susciter la mobilisation de la société, à des niveaux et dans des secteurs extrêmement différents. Ses travaux de recherche l’ont amenée à s’intéresser à un outil de mobilisation particulièrement en vogue : les sciences participatives.
Selon Frédérique Chlous, le terme générique de “sciences participatives” se cachent différentes pratiques, que l’on peut regrouper en deux tendances : “les sciences participatives en écologie invitent un grand nombre de citoyens répartis sur tout le territoire à récolter certaines données, en masse. Ces récoltes de données permettent à des chercheurs de répondre à des questions scientifiques. La recherche participative, quant à elle, relève plutôt des sciences humaines et sociales. Il s’agit de co-construire une question avec des citoyens puis de travailler avec eux à la production de données et de contenu scientifique”.
Les bienfaits des sciences participatives sont multiples. Elles fournissent de précieuses données aux chercheurs : le Muséum National d’Histoire Naturelle a par exemple pu construire un projet de recherche et rédiger un article sur le déclin des oiseaux et des insectes, observé grâce aux observations citoyennes recensées sur des plateformes de sciences participatives qui existaient depuis des années. Les sciences participatives créent également une certaine forme d’acculturation aux méthodes scientifiques, particulièrement cruciale à l’ère de la multiplication des fake news et la décrédibilisation de la science. Enfin, elles sensibilisent les citoyens à la protection du vivant. Il a d’ailleurs été prouvé que les participants aux programmes de sciences participatives adoptaient par la suite de nouveaux comportements pour protéger la biodiversité dans leur environnement. Les sciences participatives sont donc un excellent outil - parmi d’autres - pour fédérer les citoyens autour d’un projet écologique commun.
"Nos relations aux non-humains renvoient à la question de l'altérité" 🐜
La protection du vivant comme nouveau fer de lance
Ce que le travail du Conseil Scientifique de l’OFB démontre, à mon avis, c’est qu’il est nécessaire de décloisonner le sujet de la biodiversité. D’une part, elle devrait être le prisme de toutes les prises de décisions publiques : “il faudrait que la biodiversité soit au cœur de l’ensemble des politiques nationales”, confirme Frédérique Chlous. “Aujourd’hui, elle est encore très sectorialisée, en silo. Il faudrait qu’au niveau national, l’écologie soit appréhendée et considérée comme prioritaire dans tous les domaines (transports, alimentation, agriculture…)”. Après-tout, la protection du vivant ne devrait-elle pas être l’ultime objectif de notre société ?
D’autre part, les réflexions sur les relations entre humains et non-humains ne devraient pas être cantonnées aux membres du Conseil Scientifique de l’OFB et aux philosophes de l’environnement. “Cette question doit devenir un débat de société !” argumente Frédérique Clous. “D’un point de vue anthropologique, nos relations aux non-humains sont passionnantes car elles renvoient à la question de l’altérité. De ce sujet découlent toutes les questions sur les limites que l’on impose à notre société. Je pense que ce débat sur l'altérité devrait être mené par tous, le plus tôt possible”. Ouvrir ces réflexions à l’ensemble de la société, dès le plus jeune âge, nous permettrait de construire un nouveau récit collectif sur notre rapport au vivant.